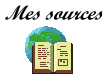DEUX SEIGNEURIES | LES DROITS FÉODAUX | UNE PREMIÈRE ADMINISTRATION MUNICIPALE | LA POPULATION ET LES MÉTIERS | LES ACTIVITÉS AGRICOLES | LE QUESTIONNAIRE DE 1790 | L’HABITAT | LES REVENDICATIONS ET LES SOUHAITS DES ACHICOURIENS DE 1789
A proximité d’Arras, Achicourt constitue en 1789 un village apparemment tranquille parce que aucun seigneur n’y réside. La paroisse dépend en fait à cette époque de deux seigneuries, un seigneur laïque, qui en 1775 est le comte de Cécilly, colonel du Régiment de Bruxelles au service de la reine de Hongrie, et un seigneur ecclésiastique, l’abbé de Saint-Vaast. Le seigneur d’Achicourt, propriétaire de 170 mesures de terre, perçoit des rentes foncières, le champart, des droits sur les boissons, sur les biens des bâtards et les biens non réclamés ; il a aussi droit de moyenne justice.
La puissante Abbaye de Saint-Vaast est propriétaire de 277 mesures affermées aux habitants du village. Outre les revenus de ses domaines, elle touche la dîme, des rentes foncières seigneuriales, le droit de relief sur les héritages, des droits de mutation et de gaule.
Les deux seigneurs semblent s’être souvent heurtés quant à leurs prérogatives sur Achicourt.
Leurs possessions sont importantes, si l’on s’en tient aux chiffres qui précèdent, c’est pratiquement 30% du sol du village qu’ils possèdent, soit 450 mesures sur un total de 1400. Ce chiffre est cependant relativement plus faible que dans les autres villages d’Artois, il est vrai qu’un certain nombre de bourgeois d’Arras étaient aussi propriétaires sur Achicourt.
On ne connaît rien des rapports entre les habitants et le seigneur laïque. Ils devaient se limiter à des perceptions de revenus. Les Achicouriens n’avaient plus en face d’eux et depuis longtemps de forteresse féodale, symbole de l’oppression seigneuriale. Quelques temps après la Révolution "s’élevait près de la rivière, au lieu dit la Seigneurie, d’un milieu de ronces, de broussailles et de sureaux, les restes d’une forte tour, ronde, d’un diamètre de 25 mètres et dont il restait sept ou huit mètres de hauteur".
Les troubles de la Grande Peur n’ont donc pas pu permettre aux Achicouriens de s’en prendre au château ! Les rapports avec l’Abbaye Saint-Vaast semblent plus difficiles.
Malgré des revenus énormes en provenance de tout l’Artois, l’Abbé de Saint-Vaast n’a pas hésité à chicaner à plusieurs reprises avec le curé d’Achicourt, aux revenus pourtant modestes, et avec ses paroissiens pour la perception de toutes petites sommes ou impôts en nature. On comprend que l’abbé et ses auxiliaires aient été mal vus des Achicouriens. La dîme représentait à elle seule une somme très importante. En 1780, le bail de la dîme affermé à Pierre François LALOUX s’élève à 44 509 livres, payable en deux termes, à la St André et la fête de la Purification. De plus, il est prévu que les "dimeurs délivreront annuellement à leurs frais à l’abbaye 600 gerbes. Ils seront tenus de faire à leurs frais les réparations du chœur de l’Église Dhées lorsque la dépense n’excèdera pas 22 livres et contribueront pour un quart à l’excédent. Ils entretiendront à leurs frais le carcan ou piloris... ils voitureront à leurs frais et sans fruits dans les greniers de l’abbaye les grains de rente et de gaule".
On voit ici le poids de l’abbaye sur la paroisse d’Achicourt !
UNE PREMIÈRE ADMINISTRATION MUNICIPALE
![]()
Sous l’Ancien Régime, les Achicouriens ont eu une administration bicéphale. La communauté d’Achicourt avait son lieutenant et ses officiers relevant du seigneur laïque. Le pouvoir de Hées, partie d’Achicourt relevant de l’Abbaye Saint-Vaast , avait aussi son lieutenant, ses échevins et son procureur nommés par l’abbaye. A la veille de la Révolution l’échevinage de Hées était composé de BIENFAIT, Lieutenant ; QUENEUTE, Échevin ; DISTINGHIN et BOCQUET, Hommes Fiefs et CAUWET, Sergent.
Les fonctions des échevins étaient multiples, ils rendaient la justice, procédaient à l’estimation des meubles et immeubles soumis au droit de relief, répartissaient les impôts (aides, centièmes, vingtièmes), veillaient à l’entretien de l’église et du presbytère. En contrepartie, ils percevaient à leur profit un droit de fouage consistant en vin, cervoise, pain, fromage et bois de chauffage.
Il semble que, bien avant la Révolution, il y ait eu des problèmes pour constituer le corps municipal. Ainsi en 1728, l’abbé doit nommer un nouvel échevinage "attendu le refus que faisèrent les personnes choisies de servir".
La Révolution apportera donc un changement considérable, c’est celui de l’élection, mais elle ne modifiera pas les mentalités : il sera quelquefois difficile de trouver des candidats.
On possède peu d’estimations sérieuses pour évaluer la population d’Achicourt avant 1789. On sait qu’en 1759 le village comportait 106 maisons et qu’en 1774 il y aurait eu 1100 habitants.
Les activités des Achicouriens sont bien entendus essentiellement agricoles. Plus de 90% des habitants sont agriculteurs; mis à part quelques fermiers, c’est-à-dire de gros exploitants locataires en grande partie, et quelques laboureurs, la masse paysanne se compose de jardiniers dont la fonction essentielle est l’approvisionnement des marchés d’Arras en légumes. Achicourt était réputée pour la qualité de ses carottes. En 1780, l’archevêque de Paris demandait au Cardinal DE ROHAN, abbé de Saint-Vaast de lui envoyer "deux litrons de graine de carotte d’Achicourt".
En plus des jardiniers, les registres paroissiaux font mention de quelques ménagers (petits paysans), des manœuvriers et journaliers qui se louent chez les fermiers.
On trouve dans le village quelques artisans nécessaires aux agriculteurs: un maréchal-ferrant, des meuniers, un charron, un tonnelier, un cordonnier, des tailleurs d’habits, un musquinier ( 4 ), des brasseurs, des cabaretiers, un fabricant et un batteur d’huile ( 5 ) et quelques dentellières.
Une enquête réalisée en 1774 permet de mieux cerner les activités agricoles, on peut les résumer de la manière suivante :
Cultures: |
|
Blé |
295 mesures (126 ha) |
Seigle |
100 mesures (43 ha) |
Orge |
207 mesures (89 ha) |
Avoine |
60 mesures (26 ha) |
Fèves,navets, pois |
280 mesures (120 ha) |
Fourrages |
113 mesures (48 ha) |
Colza-œillette |
180 mesures (77 ha) |
Jachères |
100 mesures (43 ha |
Cheptel: |
|
48 chevaux |
|
370 ânes |
|
100 moutons |
|
129 vaches |
|
12 charrues |
|
273 mesures cultivées à la bêche |
|
La physionomie du village nous est mieux connue grâce à un questionnaire de 59 articles envoyé à chaque commune par le département du Pas-de-Calais le 1er septembre 1790.
Il est intéressant d’en reproduire ici les éléments les plus significatifs pour une image d’Achicourt au début de la Révolution.
Population :
176 hommes - 178 femmes - 106 garçons - 74 filles - 406 enfants de moins de 18 ans, soit 940 habitants.
Il n’existe pas de biens communaux, mais un revenu de pâturage de 39 lt ( 6 ) par an.
Routes et chemins :
Un chemin d’Arras à Wailly |
Un chemin d’Arras à Ficheux |
Un chemin d’Arras à Agny |
Un chemin de "Beaurin à Dinville" |
Ils sont très "utiles pour les habitants de ces villages pour amener leurs denrées à Arras. Mais il faut les améliorer, en les surélevant de deux pieds et en creusant des fossés pour recevoir les eaux".
Cours d’eau :
Il existe une rivière non navigable. Pour la rendre praticable, il faudrait qu’elle soit élargie de "4 pieds dans le fond" et la terre servirait de digue qui serait d’une grande utilité pour "la conservation de propriétés voisine par les eaux sauvages".
Moulins :
Achicourt compte alors :
— Un moulin à eau "a usage de moudre bled", en bon état, il appartient à Jean Baptiste GLADIEU.
— Trois moulins à vent "a usage de moudre bled". Celui de François TABARY ne fonctionne plus, les deux autres qui appartiennent à Jean Baptiste DERRINCOURT et Matthias ANZART ont l’air d’être en service.
— Huit moulins à huile ("a tordre huile"). Tous sont en bon état, les propriétaires sont : M. CARRE (2), la veuve DUFOUR, Pierre LALOUX, François PECQUEUR, Casimir PLAISANT, Hilaire BLONDEL et Ignace BLONDEL.
Culte :
Le curé est Adrien François CUVELLIER, 61 ans, curé d’Achicourt depuis 1772. Il était auparavant chapelain de la Chapelle au Jardin à ARRAS.
La fabrique a un revenu de 84 lt 15 sols provenant de ses terres, et 5 à 600 lt produit des "oby" et places de "bans".
L’église est en bon état "rétably il y a quinze ans", mais le presbytère est "fort defectueux par son anciente age".
Ce questionnaire constitue une bonne "photographie" de la Commune. Le cours d’eau dont il est question, est, bien sur, le Crinchon qui de tous temps a posé des problèmes aux Achicouriens, malgré sa petite taille.
Déjà, en 1748, il avait détruit cinq maisons et 34 ha de récoltes. Sous la Révolution, trois autres inondations catastrophiques eurent lieu, en pluviôse an III, en pluviôse et ventôse an VII. Le 19 ventôse an VII, l’administration centrale du département du Pas-de-Calais écrit ( 7 ) : "les gravités des pertes et des dommages que viennent d’éprouver les habitants d’Achicourt par l’effet de l’inondation dont ils ont étés si fortement tourmentés provoque toute notre sollicitude... quant à votre demande tendante à autoriser les dits habitants à démolir le tour de leur Commune pour la reconstruction d’un pont détruit par les eaux nous regrettons singulièrement de ne pouvoir l’accueillir quoique cette tour ait été réservée hors de la vente de l’église pour leur usage et leur utilité, elle n’est pas moins considérée comme domaine national..."
La maison des Achicouriens est modeste, comme en témoigne cet extrait de l’inventaire après décès de Marie Élisabeth DUFOUR, veuve de Pierre LEGRAND, jardinier, établi le 6 mai 1789 en présence de leurs six enfants majeurs dont trois jardiniers et deux cabaretiers.
Cuisine : Une table, un banc, huit pots, deux chaudrons, trois casseroles de cuivre, sept plats d’étain, dix-sept plats et quatorze assiettes de faïence, deux verres, une salière, deux boîtes au poivre, deux petites armoires de bois blanc, deux écumoires de cuivre, une crémaillère, deux pincettes, une paire de pinces, un marteau de fer, sept chaises à fond de paille, un pot de fer pour soupe, dix-sept cuillères, un gobelet d’étain, onze fourchettes de fer, un miroir, huit cuillères de bois, deux faucilles, une fourche...
Place : Une garde-robe de bois, trois paires de draps, une armoire à l’antique, deux bouteilles, trois petits verres, un petit coffre, une chaise, un fauteuil, une table, un petit miroir, une grande armoire de bois blanc, trois tableaux, deux croix, une vierge, un bois de lit garni d’une paillasse, un traversin de plume, un oreiller de paille, une couverture de laine jaune, les vêtements de Marie Élisabeth DUFOUR...
Petite maison voisine : Un tonneau, un cuvier, deux seaux, un chaudron, une "maye", un tamis, six sacs, un marteau, une enclume... |
Étable : deux vaches |
Deux "bourriques" |
Écurie : Un cheval |
Trois échelles, |
une brouette. |
Cour : Une charrette |
un "mont" de paille |
Une portion de fumier |
Grange : Foin, bois, gerbes |
Grenier :Paille, deux tonneaux, un collier de cheval, colza, bois, grain battu, foin |
Jardin et champs : Bois, herse, charrue, binot. |
La veuve possédait à son décès 600 livres tournois en argent comptant. Parmi ses papiers, on relève, huit titres de propriété concernant des petites pièces de terre achetées entre 1724 et 1773; aucune d’elles de dépasse la demi-mesure de surface soit 1200 m2; plusieurs baux de location sont aussi mentionnés.
Ce n’est pas la misère, mais peu d’éléments montrent un luxe apparent. Cependant, quand on sait qu’en 1774 il n’y avait que douze charrues à Achicourt, Marie Élisabeth DUFOUR qui en possède une, fait certainement partie du groupe des jardiniers les mieux lotis (il faut aussi ajouter les diverses acquisitions de terres).
COMMENT
CONNAÎTRE LES REVENDICATIONS ET LES SOUHAITS DE CES ACHICOURIENS DE 1789
![]()
Pour beaucoup de paroisses, on a la chance d’avoir conservé les Cahiers de Doléances rédigés au début de cette année-là. Mais ce n’est malheureusement le cas pour Achicourt où le cahier a disparu. Comme les cahiers d’Agny, Beaurains, Ficheux et Tilloy les Mofflaines sont dans le même cas, on trouvera ici des extraits de ceux de Beaumetz les Loges et de Rivière. On émettra cependant des réserves sur l’exacte similitude de revendications avec Achicourt, qui a la spécialité des jardiniers, sans oublier non plus que beaucoup de cahiers de paroisses rurales ont été rédigés suivant des modèles qui circulaient.
Extraits du Cahier de Doléances de Beaumetz les Loges :
"Les habitants dudit village demandent :
1) que les procès n’aillent plus à Paris mais qu’ils soient jugés au dernier ressort dans la province,
2) qu’on diminue les impôts sur les terres. Qu’on supplée à ce retranchement par des impôts sur des objets de luxe et à la décharge de l’agriculture et de l’industrie,
3) que nous ayons un représentant à l’assemblée des Tass [...]
5) que les privilèges des nobles et des ecclésiastiques soient anéantis et qu’il s’en fasse une répartition sur les peuples des villes et campagnes,
6) qu’on ne défriche plus de bois et de marais,
7) que les portions congrues soient augmentés afin que les curés puissent secourir les pauvres."
Du cahier de Rivière on peut extraire :
"2) qu’en vertu de loix justes [...] nos libertés, nos propriétés soient à l’abri de toutes invasion et concusion [...]
9) que [...] il seroit à propos que les personnes qui occupent les charges les plus lucratives dans chacun des trois ordres fussent tenus de résider dans la province [...]
10) comme habitants des campagnes et agriculteurs nous nous plaignons très amèrement de la trop grande multitude de gibier [...]
14) que pour subvenir au besoin de l'État [...] la Nation [...] pourroit [...] s'emparer du superflus des biens de tous les abbaye qui sont en commande [...]
17) que les communes soit partagés aux pauvres de l’endroit.
18) que les pigeons soient détruits [...]
20) que le rachat des banalités soient annéantie [...]"
Ces deux extraits sont sans doute très proches des revendications des Achicouriens en 1789. En tout cas, ils reflètent les préoccupations de beaucoup de campagnes françaises à ce moment-là.
Notas
(1) la mesure de terre vaut environ 0,4 hectare (retour)
(2) le champart était un impôt féodal sur une partie de la récolte (retour)
(3) droit de relief : droit de mutation dû au seigneur en cas de transmission d'une terre
après un décès (retour)
(4) musquinier : ouvrier du textile qui fabrique baptiste et linon (retour)
(5) on fait pousser colza et œillette à Achicourt (retour)
(6) livres tournois (retour)
(7) les Achicouriens sont prêts à sacrifier leur clocher, alors que quelques temps
auparavant ils s'étaient battus pour le sauver. (retour)